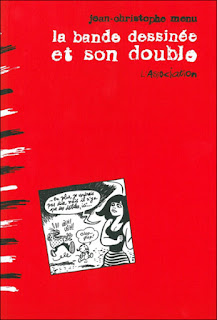Comme je vous le disais dans mon post précédent, Fabrice Neaud réalise de nombreux photomontages (dont un grand nombre sont visibles sur la rubrique dédiée du site qui lui est consacré). Il m'a accordé un entretien à propos de ce pan de son travail (disponible également ici).
Sébastien Soleille : On vous connaît surtout comme auteur de bande dessinée. Depuis quand êtes-vous passionné de photographie et de photomontage ?
Fabrice Neaud : Depuis que j'ai acquis une caméra Sonny Handicam en 2003. Je l'ai toujours, du reste, mais elle est en fin de vie. Il faut que je trouve le moyen d'acquérir un objet maniable, qui aurait les mêmes performances, avec le même zoom optique de qualité mais plus de définition dans les images. Car, en fait, ces photomontages sont venus, au départ, du manque même de définition des photos que prenaient ma caméra... et aussi du simple fait que ces photos, initialement, n'étaient que de la documentation pour des images, des cases de mes bandes dessinées...
Je prenais des photos de lieux et, parfois, ils ne logeaient simplement pas dans l'objectif. Donc je faisais une ou deux photos supplémentaires pour faire un panoramique, et ainsi avoir de plus grandes images, avec un champ plus large, pour couvrir une plus vaste partie de ce que je voulais documenter.
Alors je faisais un photomontage grossier préliminaire sur Photoshop, afin d'avoir mon document utile à la case idoine... C'est ainsi que le document utilitaire a commencer à prendre son autonomie. Au fur et à mesure que je faisais mes montages sur Photoshop, j'y passais plus de temps, je soignais davantage le rendu... Au début (peut-être entre 2004 et 2006), je pense même avoir exclusivement fait de la photographie avec une large part dévolue à des photomontages futurs.
Mais on peut dire que c'est ainsi que ça a commencé: des panoramiques grossiers et simples en vue d'une documentation pour un dessin, puis, au fur et à mesure, plus de rigueur et plus de photographies pour une seule image finale...
Sébastien Soleille : On peut noter une évolution assez franche par rapport à cet objectif initial : d'une part, vos photomontages sont maintenant beaucoup plus soignés que ce que requiert un document servant de base à un dessin ; d'autre part, on peut noter un goût marqué, dans le choix de vos dessins, pour l'architecture, et en particulier l'architecture gothique. Comment expliquez-vous cette évolution ? Et d'où vous vient ce goût si prononcé pour le gothique ?
Fabrice Neaud :Oui, l'évolution est même un changement de paradigme: passer de l'utilitaire, du "par défaut", à la fin en soi.
J'ai fini par analyser mon goût pour le gothique par le processus même utilisé pour faire les photomontages en question.
En effet, le spectateur aura noté que tous les édifices religieux pris le sont selon deux principes: la frontalité stricte (avec un redressement même des verticales pour le replacer dans une perspective à un point) et la lumière (moins stricte) qui consiste, au moment des prises de vue, d'être à une heure la plus proche d'un axe perpendiculaire à la façade. Ceci afin d'éviter, autant que faire se peut, le plus possible la "profondeur" que marquerait artificiellement les ombres.
L'idée est ainsi d'aplatir au maximum la façade du bâtiment pour n'en faire ressortir que les motifs propres à l'écriture du gothique, le dessin. D'avoir quelque chose au plus près du dessin d'étude initial, du dessin original, du "plan" qui définit l'esthétique du bâtiment.
Bien entendu, ceci est l'approche la moins rigoureuse. Il est souvent difficile de se retrouver face au bâtiment en question avec le soleil pile en face. Ceci est cependant facilité (mais pas toujours) par l'orientation des édifices religieux, est-ouest (chevet à l'est, donc face au levant) et façade occidentale, face à l'ouest (au couchant). Ainsi mes photographies sont-elles prises souvent entre 17 et 19 ou 20h.
Mais ceci dépend également de la saison...
En effet, en hiver, le soleil se couche plus tôt, et plutôt vers le sud-oust. Donc il est quasi impossible d'avoir une lumière frontale sur une façade occidentale en hiver (je prends alors les transepts sud, le nord d'un bâtiment chrétien, église, cathédrale n'étant jamais éclairé par le soleil, quelle que soit la saison... sauf en été, par une lumière rasante...).
Alors qu'en été, évidemment, le soleil se couche plus tard, et plutôt vers le Nord-ouest. Donc il y a toujours un moment où la façade occidentale d'une église reçoit la lumière frontale du soleil.
L'idéal étant la lumière d'équinoxe, un peu en aval du printemps ou en amont de l'automne (comme ce fut le cas pour l'église Notre-Dame de Lissewege, par exemple), simplement parce que la lumière y est frontale pile au moment du coucher du soleil. Sans compter que les cieux d'équinoxe offrent souvent les plus belles lumières, avec des temps chargés, des cieux roulants, des orages qui ouvrent leurs nuages au moment du couchant, comme ce fut, là aussi le cas avec les prises de Lissewege et pour Bruges, où j'ai eu la chance d'avoir un orage très violent qui m'offrit le bonheur du double arc-en-ciel dans l'axe même de la nef...
Après, la lumière ne doit pas être trop dure, avec un ciel trop bleu. Même si une telle lumière sublime la pierre, elle a tendance à marquer violemment les ombres. Sans compter les bâtiments impossibles à prendre de face car trop près d'autres bâtiments qui, soit leur projettent leur ombre dessus (Bourges cumule ces deux handicaps) soit créent une anamorphose telle que le redressement des verticales devient grotesque (c'est le cas de la cathédrale de Strasbourg ou du clocher porche de l'église de Marennes).
C'est là que la rigueur absolue de mon process de départ touche à sa limite, bien entendu. Et je fais des exceptions à cette règle.
Pour Saint-Pierre de Sales de Marennes-Oléron, j'ai privilégié le transept sud. Mais comme son clocher est vraiment impressionnant, hé bien ai-je dérogé et l'ai pris d'un angle sud-ouest, lui-même très anamorphosé.
Même chose pour la cathédrale de Mechelen (Malines, Flandres), avec un angle lui nord-ouest). Le cas de Strasbourg est un peu différent et limite à sa manière. Il y a bien une rue qui lui fait strictement face, mais les bâtiments sont si rapprochés dans cette rue et l'édifice si haut qu'on ne peut appréhender la totalité de la façade qu'en étant très/trop près (à trente mètres, tout au plus, le bâtiment en faisant 142...).
Je l'ai donc prise à cette limite extrême et réalisé une vue frontale, impossible à appréhender dans la réalité, où l'octogone ajouré de la flèche est anamorphosé à l'extrême.
Mais c'est aussi là le charme et la raison du Gothique...
En effet, nous sommes à une époque qui précède l'invention de la perspective (à un point, deux points, trois points...), donc l'invention de la profondeur par une forme de géométrie plane ramenant la 3e dimension sur la 2e, indépendamment des artifices du sfumato italien (atténuation des contrastes dans le lointain) ou de la perspective cavalière et de la gestion du blanc propre à l'Asie.
Ainsi, il serait faux de prétendre que les gens du Moyen-Âge ne "voyaient" pas la profondeur, en tout cas, ils ne savaient pas la traduire telle qu'avec les outils de la perspective.
À cet égard, j'émets l'hypothèse que le dessin, l'écriture du gothique est une manifestation même de cette représentation sans complexe de la 3D non appréhendée. Et un éloge de la frontalité et de la planéité. Ceci coïncide avec la préoccupation tardive, moderne, de ramener la peinture à la 2D (début de l'abstraction au début du XXe siècle, cubisme...). Ainsi, la frontalité même de la représentation 2D du gothique, dernier soubresaut de cette représentation avant la perspective, coïncide-t-elle avec la planéité de la toile, de la feuille, de l'écran.
J'ose dire que le gothique, le dessin gothique, est une sorte d'aboutissement et de glorification de la 2D. Tout n'est qu'entrelacs, perpendiculaires, parallèles, angles à 45° au mieux et arabesques, pure écriture. Et ceci se traduit en architecture par une écriture et une conception des bâtiments en "tranches".
Il faut bien attendre la perspective en dessin, son invention et l'arrivée de la renaissance (qui n'est que la transition du gothique, appelé "tardif" vers le... baroque). pour que l'on envisage la 3D en tant que telle et ce qu'elle génère de fécondité nouvelle à envisager.
Mes photomontages sont ainsi, à la fois dans leur processus de départ, leurs modèles et motifs, autant que dans leur temps de construction sur Photoshop, du dessin, plus que de la photographie.
Sébastien Soleille : Vous cherchez d'une certaine manière à représenter des églises gothiques idéales (au sens des idées platoniciennes, réalités parfaites, indépendantes de la perception humaine).
D'ailleurs, en vous entendant rapprocher ces travaux du dessin, je ne peux m'empêcher d'aborder un autre sujet que vos photomontages (mais nous y reviendrons). En effet vos propos me font penser à un autre de vos travaux, à savoir la conception d'une cathédrale gothique parfaite, que l'on a pu entrevoir lors de l'exposition qui vous a été consacrée il y a quelques à l'occasion du festival d'Angoulême, ainsi que dans Nu Men. Le gothique représente-t-il pour vous un idéal artistique ?
Fabrice Neaud : Le mot "parfait" me gêne quelque peu, tout de même. Ce n'est pas exactement mon intention... Je ne prétends nulle part à la perfection ni même à "une" perfection. Le terme "idéal" est plus juste, évidemment... Mais, là aussi, sans aucune intention totalitaire d'imposer cet idéal à qui que ce soit. Abadie ou Viollet-Le-Duc avaient aussi des conceptions "idéales" du gothique... Et leur idéal (ou leurs idéaux) ne me conviennent pas. Or, eux, ont eu le pouvoir entre les mains d'imposer cette vision dans la chair même des bâtiments dont ils ont eu la charge. Je n'ai ni ce pouvoir (je ne suis pas architecte) ni l'ambition de ce pouvoir. Certes, s'il m'était donné, dans un monde "idéal", de pouvoir mener à bien mes expérimentations architecturales, je sauterais dessus... Mais, bien que je sois en-dessous du talent d'un Schuiten, par exemple (qui est architecte lui-même), ma, mes conceptions "idéales" de l'architecture et de l'architecture gothique restent bien dans le cadre du dessin, voire de la bande dessinée.
Je m'inscris ici sans aucun doute dans la tradition picturale romantique qui réinvestit le gothique de ses propres concepts et idéaux, forcément discutables (qu'est-ce qui ne l'est pas ?) mais néanmoins légitimes, dans une démarche plastique qui est le propre du travail d'un artiste ou d'un auteur (mon cas, le cas de Schuiten).
Ceci étant, pour revenir un moment à la photographie avant de répondre à la question du dessin, ma conception "idéale" des cathédrales photographiées restent moins celle des bâtiments (des objets, des modèles) que celle de leur perception.
L'angle de vue adopté (la frontalité), la lumière dont je parlais, le redressement des verticales pour rapprocher l'image photographique de l'étude ou du carton servant de modèle préliminaire à l'élévation de l'édifice, tout ceci montre davantage une conception "idéale" de la perception (donc du sujet observant) que de l'objet perçu (observé).
Ainsi, le processus de mes photomontages expose une vision. Ils parlent bien plus de MON angle de vue, de ma perception, de ma conception d'une certaine perception (théâtrale - le "point de vue du Prince", par exemple) que des objets eux-mêmes perçus, dessinés ou photographiés.
Ces photomontages seraient presque à rapprocher du photomaton, de la photo d'identité. Et c'est là que je rejoins le dessin. Car j'aime, dans la représentation même des gens, d'autrui, la même frontalité un peu froide, un peu policière ou médicale. C'est l'idée même de l'objectivité. Non pas comme prétention de donner l'objet dans sa vérité nue, unique, unilatérale et indiscutable (nous savons que celle-ci est impossible, inexistante, fictive et même non-souhaitable) mais comme l'épure même de la subjectivité de tout son pathos et toute attache émotionnelle, affective.
C'est un peu comme si j'arrivais à faire rentrer les cathédrales dans un photomaton pour dresser leur portrait "légal".
Mais, plus simplement, comme je le disais plus haut, je rapproche simplement l'image réelle du bâtiment de son dessin préliminaire, du carton dressé pour son étude finale.
En ceci, l'idée n'est pas de faire correspondre le bâtiment réel à son idéal (quoique, dans le cadre de Cologne, j'ai corrigé l'échafaudage disgracieux qui en défigurait un des angles de la tour nord... mais la symétrie du bâtiment lui-même m'a permis ce "copié-collé", et Cologne est elle-même une cathédrale conçue comme "idéale" par ses concepteurs initiaux...) mais de donner une perception "idéale" de sa réalité hic et nunc.
Pour revenir à Saint-Pierre d'Urstaadt, "ma" cathédrale "idéale", nous sommes bien dans la démarche inverse, du moins une démarche plus proche de celle de Viollet-le-Duc : donner une vision "idéale" d'un gothique fantasmé.
C'est aussi pour cela qu'elle intervient dans Nu-Men (et elle devait apparaître dans sa gloire au 3e tome...), mais précisément dans une autre dimension que la nôtre, une dimension plus proche du monde des idées platoniciennes, en effet, coincé quelque part entre le monde du rêve (de Sandman ou du Docteur d'Authority...) et celui des dimensions enroulées sur elle-même que nous proposent certaines théories scientifiques...
Sébastien Soleille : Vos photomontages ne concernent cependant pas uniquement des églises gothiques. Vous semblez beaucoup apprécier également le quartier de La Défense et en particulier la Grande Arche. Rien ne trouve grâce à vos yeux entre le gothique et l'architecture contemporaine ? Et au sein de celle-ci, que vous semblez apprécier et que vous dessinez avec brio (cf. Nu Men encore), pourquoi vous focalisez-vous ainsi sur ce quartier en particulier ?
Fabrice Neaud : Ah. Là, je crains de ne pouvoir vous répondre vraiment...
Il est vrai que j'aime le gothique (large, du premier gothique au gothique le plus tardif) et beaucoup l'architecture contemporaine (large également, puisque l'on peut reculer jusqu'aux fifties)...
Cela ne veut pas dire que je n'aime pas toute autre architecture... loin de là.
Il est vrai que, concernant l'architecture religieuse (chrétienne), j'ai du mal à aimer au-delà du gothique tardif. Les églises baroques, par exemple, me semblent toujours ressembler trop à des bibelots. Et les églises classiques m'intéressent peu. Ces histoires de "temples de la raison" ont fait perdre aux bâtiments religieux leur dimension mystique... mais ceci est un avis très personnels.
Je pourrais aimer l'antiquité mais, comme c'est l'essentiel de l'inspiration du classicisme, pour les mêmes raisons, j'ai un peu de mal avec l'architecture antique...
Mais, ne nous trompons pas, je parle de tout cela comme possible modèles photographiques, évidemment, entrant dans le processus que j'ai décrit. D'un point de vue strictement esthète, je pense que j'aime à peu près TOUT, tous les paysages urbains, tous les paysages.
J'ai quand même de nombreux photomontages de paysages de montagnes, même s'ils n'obéissent pas aux mêmes principes de "frontalité" (j'y cherche davantage la lumière, les contrastes de formes, de matières...).
On pourrait me reprocher de ne pas aimer le Roman. Ce qui est faux. J'ai quelques images d'édifices romans. Si je les affectionne moins, c'est pour les raisons évoquées : ils précèdent cette manifestation ultime de la planéité, dont le gothique me semble le dernier éclat (avant l'invention de la perspective).
Mais, surtout, vivant dans une région où le Roman est roi (sans jeux de mots avec un certain livre de Renaud Camus...), j'avoue que j'en ai pas mal "soupé".
Je baigne dans le Roman à longueur de journée. Et il existe une sorte de préciosité d'esthète qui consiste à trouver le Roman plus subtil que le gothique, plus "authentique", plus mystique... et de voir dans le gothique un art vulgaire, de propagande, un truc ampoulé d'ingénieurs (au mieux) où de petits tyrans ecclésiastiques. Un peu comme le conflit Wagner/Verdi, Beatles/Rolling Stone, Hergé/Franquin, Star Wars/Star Trek...
Musique symphonique vs. musique de chambre...
Pornographie/érotisme... Et comme je garde un esprit rebelle, je vais toujours à l'opposé de ce qu'on m'impose d'aimer pour des raisons que je trouve fallacieuses. C'est bien le geste d'ingénieur qui me touche dans le gothique (plus que la "propagande" ou l'assise d'un pouvoir délirant) et j'ai toujours eu une préférence pour ce qui est ultime, tardif, fin de... plutôt que primitif, originaire, principiel. J'aime ce qui est au bord de l'effondrement, post-, terminal, d'où mon amour pour la tragique cathédrale de Beauvais, par exemple, qui, bien qu'elle tienne vaillamment debout, est une cathédrale de l'échec, l'Icare de l'architecture gothique, écroulée deux fois, inachevée, trop grande, trop grosse...
Là aussi, ma réponse est moins rigoureuse, plus émotionnelle, affective, que mon dispositif esthétique. Mais bon, je n'en ai pas d'autres.
Sébastien Soleille : Et dans l'architecture moderne, pourquoi cet attrait pour le quartier de La Défense en particulier ?
Fabrice Neaud : Honnêtement, je n'ai pas l'impression d'être particulièrement attiré par la Défense plus qu'un autre quartier. Il se trouve que c'est celui que je fréquente le plus souvent quand je voyage (je vais régulièrement à Paris).
Inversement, j'ai été très attiré par le quartier des Confluences et le musée du même nom (en cours de finition) à Lyon. Je n'ai simplement pas fait de photomontage de ce lieu [après vérification, au moins un photomontage, disponible sur ce site, a été réalisé], plutôt des dessins, curieusement. Et, notamment, un très grand dessin, en me positionnant en dessous de la six voies, seul endroit qui me permettait d'être assis pour dessiner pendant de longues heures.
Il se trouve que j'aimerais bien connaître d'autres quartiers, lieux, avec des architectures contemporaines remarquables mais je n'ai pas eu trop l'occasion. De surcroît, j'ai toujours cru noter qu'il existait une iconographie existante sur l'architecture contemporaine curieusement plus nourrie que les églises que je prends en photo.
Taschen possède une collection "Architecture Now" qui est très large.
Cet entretien a été réalisé par messagerie électronique entre le 26 avril et le 1er mai 2014.