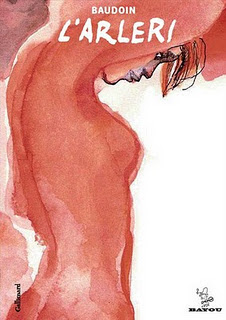J'ai dressé la liste, dans six messages, de ma « bédéthèque idéale ». Bien entendu, une liste comme celle-ci n'est jamais tout à fait close. J'en ai exclu certains titres après beaucoup d'hésitation. D'autres sont absents tout simplement parce que je ne les connais pas suffisamment ou que je les ai lus il y a trop longtemps pour en conserver une idée précise. Voici aujourd'hui une liste de ces titres laissés pour compte.
Je n'ai pas cité les œuvres de Mattt Konture (depuis 1983, France). Ce disciple français de Crumb nous livre depuis des années une œuvre, majoritairement autobiographique, forte et originale. Essentiellement constituée de courts fragments, en grande partie improvisée, elle nous fait découvrir les angoisses, les déprimes et, plus rarement, les joies de Mattt Konture et de ses multiples avatars, d'Ivan Morve le mort-vivant à Galopu en passant par Mistor Vrö.

J'ai omis également les œuvres de Nikita Mandryka (notamment Le Concombre masqué, depuis 1975, France) et de Claire Brétécher (notamment Les Frustrés, 1975-1980, France) car je les connais assez mal. Je sais cependant que ces deux cofondateurs (avec Marcel Gotlib) de l'Écho des savanes sont des auteurs originaux à la forte personnalité et qu'ils ont tous deux, chacun dans leur style, apporté un souffle résolument nouveau à la bande dessinée francophone, Mandryka avec son humour nonsensique et son tropisme pour la psychanalyse, Brétécher avec ses tranches de vue si bien vues.
Parmi les auteurs pour lesquels j'ai beaucoup de respect mais que je connais mal, je pourrais également citer Reiser ou Gébé.
J'ai cité relativement peu d'auteurs parfois regroupé sous l'appellation de "nouvelle bande dessinée". Si j'avais dressé une liste similaire il y a une dizaine d'années, j'y aurais très probablement inclus La Fille du professeur, de Joann Sfar et Emmanuel Guibert (1997, France), Approximate Continuum Comix, collecté sous le titre d'Approximativement, de Lewis Trondheim (1993-1994, France), ou Léon la came, de Sylvain Chomet et Nicolas de Crécy (1995, France). Avec le recul, ces albums, bien qu'excellents, ne me semblent pas avoir l'importance que je leur accordais à l'époque. En outre, à part les très imaginatifs Lewis Trondheim et Joann Sfar, un certain nombre d'auteurs rassemblés sous cette appellation sont d'excellents dessinateurs mais, à mon sens, n'ont pas grand chose à raconter.

Ordinary Heroes, une aventure des Gen 13, d'Adam Hughes (1996, États-Unis). Je ne sais pas si Adam Hughes a publié d'autres récits en tant qu'auteur complet. En tout cas, il nous fournit ici avec ce double comics une histoire au scénario habile et avec un retournement final bienvenu. Et, surtout, il y a son dessin : fondé sur de bonnes connaissances anatomiques, variant du réalisme quasi-photographique à certains dessins plus 'cartoon', à l'encrage habile donnant du volume aux personnages, c'est un des styles qui ont eu le plus d’influence depuis le milieu des années 1990. Les imitateurs sont nombreux : John Cassaday (Planetary), Bryan Hitch (The Authority), David Mack, etc. Depuis ce récit, Adam Hughes a encore dessiné un ou deux récits et se consacre en fait essentiellement aux dessin de couvertures...
The Life and Times of Scrooge Mc Duck, de Ken Don Rosa (1994, États-Unis). Ken Don Rosa reprend les choses là ou Carl Barks les avait laissé. Il reprend tous les indices parsemés par celui-ci dans ses récits et comble le récit pour nous offrir la jeunesse de Picsou. Par la même occasion, il nous fait parcourir le monde et plus d'un siècle, au gré des aventures truculentes et hautement réjouissantes du canard le plus riche du monde...

Je connais très mal Gasoline Alley, de Frank King (1921-1969, États-Unis), et les bandes dessinées de Jules Feiffer (depuis 1949, États-Unis). Ces œuvres sont souvent citées comme de grands chefs-d’œuvre. Elles sont en cours de réédition aux États-Unis. Je vous en reparlerai peut-être quand j'en aurai lu davantage...
J'ai également hésité à inclure dans ma liste Le Chat du rabbin de Joann Sfar (2002-2006, France), L'Homme qui marche, de Jiro Taniguchi (1990-1991, Japon), Lone Wolf and Cub, de Kazuo Koike et Goseki Kojima (1970-1976, Japon), Demi-tour de Benoît Peeters, Frédéric Boilet et Emmanuel Guibert ( 1997, Belgique-France), Georges et Louis romancier, de Daniel Goossens (depuis 1993, France), Les Cités Obscures, de Benoît Peeters et François Schuiten (depuis 1983, Belgique)...
Avant de conclure (provisoirement ?) sur ce sujet, je souhaite citer deux listes de « bédéthèque idéale » auxquelles j'aime bien me référer : Les 100 comics essentiels du Comics Journal et les « 100 œuvres remarquables de la littérature dessinée parues entre 1732 et 1999 » d'Harry Morgan. La première ne cite que des auteurs anglo-saxons. La seconde est très intéressante pour sa large amplitude chronologique ; elle affiche une préférence marquée pour les œuvres de type feuilletonnesque (on peut ainsi noter que, de Lewis Trondheim, elle cite Les carottes de Patagonie, pastiche de l'héroïc fantasy, très à la mode à la date de publication de ce pavé, plutôt que, par exemple, Approximativement ; et l’œuvre citée de Jacques Tardi est Adèle Blanc Sec, pastiche des romans feuilleton du début du XXe siècle, plutôt que des œuvres plus ambitieuses telles que C'était la guerre des tranchées).